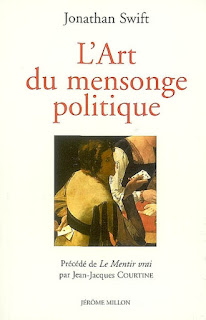2025-07-26
30 biais cognitifs qui nuisent à la pensée rationnelle
2025-07-25
Max Weber, La Ville : Quand la Commune Médiévale Inventa l'Occident Moderne
Max Weber, La Ville : Quand la Commune Médiévale Inventa l'Occident Moderne
Et si le capitalisme, la démocratie et l'État bureaucratique étaient nés dans les rues pavées des villes médiévales ? Dans La Ville, le géant de la sociologie Max Weber révèle pourquoi la commune occidentale fut un laboratoire unique de la modernité – et en quoi Athènes ou Rome, malgré leur grandeur, échouèrent à enclencher cette révolution.
Introduction : Le Paradoxe Urbain
« L'air de la ville rend libre »
Ce vieil adage médiéval résume l'intuition géniale de Weber : la ville occidentale n'est pas un simple lieu de peuplement, mais le creuset politique et économique qui forgea notre monde. Contrairement aux cités antiques ou orientales, la commune médiévale (Italie, Flandres, Allemagne) y apparaît comme une exception historique.
1. Deux Modèles, Deux Destins
La Cité Antique : Guerre et Tribus
Athènes/Rome : Des corporations guerrières fondées sur :
- Les liens du sang (tribus, gentes)
- L'économie esclavagiste
- La conquête militaire (impérialisme)
« Le tribunat de la plèbe romaine ou les éphores spartiates obtiennent des droits politiques, mais jamais ne bouleversent l'ordre économique fondé sur l'esclavage. »
La Commune Médiévale : Marché et Serment
Venise, Florence, Bruges : Des laboratoires de liberté uniques grâce à :
- La conjuration (conjuratio) : Serment d'entraide
- La rationalité économique : Corporations, travail libre
- L'autonomie juridique : Affranchissement des serfs
« Le christianisme dissout les solidarités magico-tribales : la ville devient une communauté d'individus, non de lignages. »
2. Le Grand Basculement : Du Patricien au Bourgeois
L'Âge des Oligarques
Patriciens médiévaux (ex: Nobili de Venise) ou noblesse antique :
- Dominent par la rente foncière ou les monopoles
- Excluent artisans et marchands du pouvoir
La Révolte du Popolo
Révolution plébéienne (Italie, XIIIe siècle) :
- Création de contre-institutions autonomes
- Victoire du droit corporatif comme fondement du pouvoir
« Là où Rome n'accorda que des tribuns, le Popolo impose une nouvelle légalité. »
3. Antique vs Médiéval : Le Choc des Rationalités
| Critère | Cité Antique | Commune Médiévale |
|---|---|---|
| Acteur dominant | Citoyen-paysan-soldat | Bourgeois-artisan |
| Base économique | Esclavage & conquête | Marché & travail libre |
| Logique sociale | Ordres tribaux/militaires | Corporations de métiers |
| Finalité | Expansion impériale | Accumulation capitaliste |
| Héritage | Démocratie guerrière | État rationnel-bureaucratique |
« La cité antique fut une "corporation guerrière" ; la médiévale, une "corporation industrielle". »
4. Pourquoi Relire Weber Aujourd'hui ?
- Comprendre la tension entre autonomie locale et bureaucratie
- Éclairer l'impuissance urbaine contemporaine
- Penser l'actualité de l'auto-gouvernement
« Les villes modernes ont-elles perdu l'esprit de conjuratio qui fit leur grandeur médiévale ? »
Conclusion : Le Laboratoire Oublié
La Ville de Weber n'est pas qu'un traité d'histoire : c'est une généalogie de nos libertés et de nos contraintes. La commune médiévale y surgit comme le lieu où naquirent, intimement mêlés :
- L'individualisme moderne
- La rationalité économique
- L'État bureaucratique
« Son génie fut de montrer que le "carcan d'acier" du capitalisme et de l'État rationnel est le fils paradoxal de la liberté urbaine médiévale. Relire Weber, c'est retrouver la mémoire des possibles. »
À lire : Max Weber, La Ville (Éditions Les Belles Lettres), édition préfacée et annotée – un texte fondateur pour décoder les défis politiques actuels.
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251200385/la-ville2025-07-20
Le Mensonge comme Moteur d’une Société Profitable
Dans un monde où l’information circule à une vitesse fulgurante, le mensonge apparaît non seulement comme une réalité inévitable, mais aussi comme un outil potentiellement profitable. En effet, une société qui utilise le mensonge de manière stratégique peut favoriser des gains économiques et sociaux. Cependant, cette dynamique s’accompagne d’un coût : l’isolement de l’individu dans un univers de divertissement qui comble les illusions.
La Stratégie du Mensonge
Le mensonge, lorsqu'il est utilisé à des fins commerciales, peut prendre plusieurs formes. Par exemple, la publicité repose souvent sur des exagérations ou des promesses non tenues. Les entreprises créent des narrations séduisantes qui attirent les consommateurs, les incitant à acheter des produits dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Cette manipulation de la vérité peut générer des profits considérables.
1. L'illusion de la consommation
Les marques construisent des mythes autour de leurs produits, promettant un style de vie enviable en échange de l'achat. Les consommateurs, en quête de validation sociale, se laissent entraîner dans cette spirale de consommation. Ainsi, le mensonge devient un moteur de l'économie, alimentant un cycle où le besoin de posséder est perpétuellement renouvelé.
L'Isolement de l'Individu
Dans cette quête de profit, l’individu est progressivement isolé. Le divertissement, qu'il soit numérique ou traditionnel, joue un rôle clé dans ce processus. Les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et les jeux vidéo créent des environnements immersifs qui détournent l'attention des réalités plus sombres de la vie quotidienne.
2. Le divertissement comme échappatoire
Le divertissement devient une échappatoire face à un monde souvent difficile et décevant. Les individus plongent dans des réalités alternatives, où les mensonges sont embellis par des récits captivants. Cette immersion permet de combler les vides laissés par des vérités inconfortables, mais elle renforce également l’isolement. Les relations interpersonnelles s’effritent, remplacées par des interactions superficielles en ligne.
Les Illusions Sociales
Le mensonge et le divertissement ne se contentent pas d’isoler l’individu ; ils façonnent également la perception collective de la réalité. La société devient ainsi un espace où les illusions prédominent, créant des attentes irréalistes et des standards de réussite inaccessibles.
3. La quête de l’authenticité
Dans un monde saturé de mensonges, la quête de l’authenticité devient un défi. Les individus, en cherchant à se démarquer, peuvent adopter des comportements qui renforcent encore plus cette illusion. Les réseaux sociaux, par exemple, encouragent la mise en scène de vies idéales, alimentant un cycle de faux-semblants.
Conclusion
En somme, le mensonge, utilisé comme un outil stratégique, peut effectivement rendre une société plus profitable économiquement et socialement. Cependant, cette approche engendre un isolement croissant des individus, piégés dans un monde de divertissement qui comble les illusions. La question qui se pose est alors de savoir si cette profitabilité vaut le prix de l’authenticité et des vérités humaines. Dans cette dynamique, il devient crucial de réfléchir à l’équilibre entre le mensonge, le profit et le bien-être social.
Auteur : Pascal Walter | 23 mars 2025
Génération assistée par DeepSeek-R1
2025-06-29
une démocratie où les élites fuient leurs responsabilités
La Trahison des élites : Christopher Lasch et l'implosion de la démocratie
"Il fut un temps où la menace venait des masses. Aujourd'hui, elle vient des sommets." Dès l'ouverture de La Révolte des élites (1996), Christopher Lasch retourne comme un gant la thèse d'Ortega y Gasset. Ce livre-testament, écrit à l'agonie, dévoile une oligarchie en rupture avec le peuple – et avec la démocratie elle-même.
Le nouveau nomadisme des élites
Lasch diagnostique un déracinement volontaire des classes professionnelles-managériales :
"Le prix de l'ascension sociale est un mode de vie itinérant. [...] Ils associent le domicile fixe aux voisins inquisiteurs, aux conventions hypocrites."
Ces élites se regroupent sur les côtes, "tournant le dos au pays profond", cultivant un mépris pour l'Amérique moyenne – jugée "ringarde", "réactionnaire" et "sexuellement répressive". Leur allégeance ? Un marché mondialisé où l'argent, le luxe et la culture pop circulent sans frontières.
Multiculturalisme : l'exotisme sans engagement
Leur adhésion au multiculturalisme révèle une conscience de touriste :
"Un bazar universel où l'on jouit de cuisines exotiques, de musiques tribales... sans s'engager sérieusement."
Cette consommation superficielle de la diversité, note Lasch, corrode le patriotisme et l'attachement aux communautés locales. L'élite ne se pense plus comme citoyenne, mais comme cliente d'un monde global.
La grande polarisation : gated communities vs misère
Les villes deviennent des champs de bataille sociaux :
"Nos grandes villes se polarisent ; la riche bourgeoisie intellectuelle se barricade dans des beaux quartiers [...] contre la misère qui menace de les submerger."
Les élites privatisent sécurité, éducation et santé, abandonnant l'espace public. Leur promesse ? Une "promotion sélective des non-élites" dans leur caste – jamais l'égalité réelle.
L'agonie du débat public
Le mépris des élites pour le peuple devient prophétie autoréalisatrice :
"Les 'gens de bien' doutent que le citoyen ordinaire saisisse les problèmes complexes. [...] Le débat démocratique dégénère en foire d'empoigne."
Résultat ? Un paradoxe toxique :
- Les Américains sont "inondés d'informations" mais "notoirement mal informés"
- Exclus du débat, ils perdent tout intérêt pour la chose publique
- "C'est le débat seul qui donne naissance au désir d'informations utilisables"
Universités : les savoirs en miettes
Lasch fustige la fragmentation des savoirs :
"Les minorités remplacent la culture commune par des black studies, feminist studies, gay studies... Une fois le savoir réduit à l'idéologie, il suffit de diaboliser l'adversaire."
Cette logique identitaire tue la confrontation intellectuelle. Pire : elle consacre le divorce entre théorie et pratique, entre "l'esprit et le corps".
Le testament d'un Cassandre
30 ans après sa mort, Lasch reste brûlant d'actualité :
- Les Gilets jaunes et le Brexit ont incarné la fracture élites/peuple
- Les campus sont des champs de bataille identitaires
- L'espace public se réduit à des "foires d'empoigne" médiatiques
"Les choses tombent en morceaux ; le centre ne peut tenir", citait-il Yeats. Son livre n'est pas un manifeste, mais un avertissement : une démocratie où les élites fuient leurs responsabilités civiques est condamnée à l'implosion.
"L'espoir est dans les communautés qui résistent à la dissolution."
Christopher Lasch, La Révolte des élites
Publié le 30 juin 2025 • Blog Littéraire
L'Hypocrisie Politique en France
L'Hypocrisie Politique en France : Dynamiques Comportementales et Désagrégation Sociale
Une analyse multiniveau ancrée dans les sciences humaines
L'hypocrisie politique, définie comme le décalage entre les principes affichés et les pratiques réelles, constitue un phénomène central dans la crise de légitimité des démocraties occidentales. En France, cette hypocrisie institutionnalisée fragmente le tissu social à tous les niveaux.
Cette analyse explore les manifestations et conséquences de l'hypocrisie politique à travers quatre dimensions interconnectées : politique, économique, sociale et privée, tout en examinant le rôle amplificateur des médias et réseaux sociaux.
Dimensions de l'Hypocrisie Politique
Dimension Politique
Manifestations principales
- Discours universalistes vs pratiques clientélaires
- Instrumentalisation du suffrage
- Contournement des verdicts populaires
Éclairages scientifiques
- Pierre Bourdieu : L'hypocrisie comme "capital symbolique inversé"
- Pierre Rosanvallon : La défiance comme "souveraineté négative"
- Chantal Mouffe : Le déni des conflits nourrit les populismes
Dimension Économique
Manifestations principales
- "Double discours" sur la justice sociale
- Subventions aux énergies fossiles vs taxation des ménages
- Méritocratie proclamée vs reproduction des élites
Éclairages scientifiques
- Thomas Piketty : La méritocratie comme récit justifiant les inégalités
- Olivier Godechot : La financiarisation accroît la perception d'un système truqué
- Annie Cot : L'hypocrisie sape la confiance dans le contrat social
Dimension Sociale
Manifestations principales
- Repli communautaire et identitaire
- Effritement des solidarités intergénérationnelles
- L'école comme "dispositif hypocrite de tri social"
Éclairages scientifiques
- Robert Putnam : La défiance politique corrode le "capital social"
- Didier Fassin : Universalisme proclamé vs gestion différentielle des populations
- Séraphin Alava : Perception de l'hypocrisie institutionnelle par la jeunesse
Sphère Privée
Manifestations principales
- "Schizophrénie sociale" et dissonance cognitive
- Méfiance relationnelle généralisée
- Intériorisation de l'échec et souffrance psychique
Éclairages scientifiques
- Richard Sennett : Destruction du "récit de soi"
- Eva Illouz : Transformation des relations en transactions suspicieuses
- Alain Ehrenberg : L'injonction méritocratique produit l'épuisement dépressif
Conséquences Comportementales
Désengagement civique
Taux d'abstention record (jusqu'à 53% aux législatives 2022), effondrement de l'adhésion partisane et syndicale.
Radicalisation politique
Progression des votes protestataires (RN : 89 députés en 2024) et de la gauche radicale comme réponse à la crise de représentation.
Fragmentation sociale
Repli identitaire (40% des 18-24 ans jugent la religion plus importante que la citoyenneté - IFOP 2023) et effritement des solidarités.
Pathologies psychiques
Hausse des dépressions liées au "sentiment d'impuissance" (+18% en 5 ans - Santé Publique France) et dissonance cognitive généralisée.
Interconnexions et Effets Systémiques
Boucles de Rétroaction
Politique
Désengagement civique → Affaiblit le contrôle des abus économiques
Économique
Cynisme consumériste → Accroît les inégalités sociales
Social
Repli communautaire → Fragmente la sphère privée
Privé
Dissonance cognitive → Mine la légitimité politique
Médias et Réseaux Sociaux
Médias Traditionnels
Manifestations
- Traitement asymétrique des affaires politiques
- Journalisme de "restitution" des éléments de langage
- Conflits d'intérêts des propriétaires de médias
Conséquences
- Seulement 24% des Français font confiance aux médias
- Désengagement critique et préférence pour les formats courts
- 61% estiment que "les médias aggravent les tensions sociales"
Réseaux Sociaux
Manifestations
- Hyper-personnalisation des contenus par algorithmes
- Démultiplication virale des contradictions politiques
- Accélération de la temporalité médiatique
Conséquences
- Effet de chambre d'écho et radicalisation
- Culture du fragment et appauvrissement de l'argumentation
- 71% des jeunes perçoivent la politique comme "théâtre d'hypocrisie"
Conclusion : L'Urgence d'une Réinstitution Symbolique
L'hypocrisie politique en France apparaît comme un virus institutionnel qui corrode les comportements démocratiques à tous les niveaux. Sa manifestation la plus toxique réside dans la conversion de la souveraineté populaire en simple outil de légitimation des choix élitaires.
Plutôt que des solutions utopiques, cette crise exige :
- Reconnaître la trahison des élites comme facteur central du désenchantement démocratique
- Remplacer la "démocratie d'audience" par une démocratie de la coproduction
- Restaurer l'école comme laboratoire du lien social
Bibliographie Indicative
- Bourdieu, P. (2012). Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992. Seuil.
- Rosanvallon, P. (2006). La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance. Seuil.
- Piketty, T. (2019). Capital et Idéologie. Seuil.
- Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
- Sennett, R. (1998). The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. Norton.
- Fassin, D. (2011). La Force de l'ordre. Une anthropologie de la police des quartiers. Seuil.
2025-03-14
La Démagogie depuis Athènes
La Sociologie par Bernard Lahire
Passant leur temps à dire le bien et le mal, certains acteurs politiques, certains journalistes-éditorialistes et certains essayistes sans discipline (dans tous les sens du terme) ont bien du mal à comprendre qu’il puisse exister des travaux de recherche ayant pour seul but de donner à comprendre l’existant de la façon la plus rationnelle possible, et non à le juger ou à proposer des moyens de le transformer. Leurs fonctions, comme les lieux et les filières de formation par lesquels ils sont passés, ne les prédisposent guère à comprendre ce que sont ces sciences."
Extrait page 15 .
Bernard Lahire,
directeur de recherche CNRS, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber) et membre senior de l'Institut universitaire de France, a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels L'Homme pluriel (Nathan, 1998), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010), Dans les plis singuliers du social (La Découverte, 2013), Ceci n'est pas qu'un tableau (La Découverte, 2015), L'Interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018) et Enfances de classe (Le Seuil, 2019).
Extrait Presse :
Délinquance, vote d'extrême droite, terrorisme : voilà plus de quinze ans que revient régulièrement dans la bouche des responsables politiques l'argument selon lequel la sociologie " excuserait " les comportements les moins acceptables en mettant en évidence le poids des déterminismes sociaux, niant par là le fait que les individus sont responsables de leurs actions. Le sociologue Bernard Lahire tord le cou à cette idée aussi étrange que puissante, qui relève selon lui de la "confusion des perspectives" : "Comprendre est de l'ordre de la connaissance (laboratoire). Juger et sanctionner sont de l'ordre de l'action normative (tribunal). Affirmer que comprendre "déresponsabilise" les individus impliqués, c'est rabattre indûment la science sur le droit.
De cette approche simpliste, il critique également la vision de la pauvreté (qui n'est pas un simple attribut, mais une situation qui façonne tout un rapport au monde) et de la sociologie (qui ne se résume pas à l'étude des collectifs). Bernard Lahire plaide en conclusion pour un enseignement généralisé et adapté des sciences sociales dès l'école primaire, qui aurait notamment pour vertu de rendre "la vie plus dure à toutes les formes d'ethnocentrisme et de mensonge". Une belle ambition, qui ne risque malheureusement pas d'améliorer l'image de la sociologie auprès des hommes politiques...
2016-01-01 - Xavier MOLENAT - Alternatives économiques
"Comprendre les phénomènes sociaux n'est pas les excuser ou les dénoncer, rappelle-t-il ; en revanche, les comprendre est nécessaire pour donner à la démocratie une chance de les maîtriser.
2016-04-04 - Pour la Science
Liens infos +
https://www.editionsladecouverte.fr/pour_la_sociologie-9782707188601
Extrait livre
https://www.calameo.com/read/000215022deb60d2cd00d
Wikipédia
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lahire
Interview
2025-02-14
Public opinion par Walter Lippmann
Les intellectuels disent depuis un siècle que la démocratie est en échec. Ils ont tort.
L’ouvrage de Walter Lippmann , Public Opinion , publié en 1922, est la critique de la démocratie la plus convaincante que j’aie jamais lue. Peu après sa publication, John Dewey, grand défenseur de la démocratie et philosophe américain le plus important de l’époque, a qualifié le livre de Lippmann de « critique la plus efficace de la démocratie telle qu’elle est conçue actuellement ».
Lippmann pose une question simple : les citoyens peuvent-ils acquérir une connaissance de base des affaires publiques et ensuite faire des choix raisonnables sur ce qu’ils doivent faire ? Sa réponse est non, et l’objectif de ce livre est de mettre en évidence l’écart entre ce que nous considérons comme la démocratie et ce que nous savons du comportement réel des êtres humains.
La plupart des théoriciens de la démocratie du XXe siècle pensaient qu’une plus grande information permettrait d’informer davantage les citoyens, et qu’une plus grande information permettrait de tenir la promesse fondamentale de la démocratie. Ils avaient tort. Une plus grande information ne conduit pas nécessairement à une participation civique plus éclairée. Elle est tout aussi susceptible d’entraîner davantage de bruit, de partisanerie et d’ignorance (cliquez ici , ici et ici pour des recherches qui le confirment). En effet, les électeurs mieux informés se trompent davantage sur leur propre camp.
La deuxième moitié du livre tente de résoudre tous les problèmes mis au jour dans la première partie. Lippmann échoue ici de manière spectaculaire, et il échoue parce que sa solution aux problèmes de la démocratie consiste à abandonner tout ce qui fait la valeur de la démocratie. Il n’a pas su trouver comment guider intelligemment l’opinion publique, alors il a cherché à la transcender complètement en créant un « bureau d’experts » qui déciderait de la politique publique au nom du public. Mais ce n’est pas du tout une démocratie ; c’est au mieux une technocratie, au pire une oligarchie.
Aujourd’hui, le pessimisme de Lippmann est à la mode. Après le Brexit et l’élection de Donald Trump, un genre littéraire non fictionnel a émergé, cherchant à expliquer comment les démocraties meurent ou pourquoi le libéralisme occidental est en recul . Les experts et les analystes affirment que la démocratie est en « déclin » dans le monde entier et que l’Amérique se transforme en un État autoritaire.
C’est pourquoi il est important de noter que, aussi convaincant que soit le diagnostic de Lippmann sur les défauts de la démocratie, il semble avoir omis un élément essentiel concernant l’élasticité des systèmes démocratiques. Après tout, nous voici, près d’un siècle plus tard, et l’Amérique est devenue plus puissante, plus tolérante, plus riche et même plus démocratique. Peut-être que cette divergence contient aussi des leçons pour notre moment de panique actuel.
Ils imaginaient que les citoyens, quelle que soit l'étendue de l'État, continueraient à fonctionner comme ils le faisaient dans les petites communautés autonomes qui existaient au XVIIIe siècle. Autrement dit, ils seraient appelés à prendre des décisions sur des questions dont ils avaient une expérience directe. Ils pensaient à des agriculteurs blancs, de sexe masculin, propriétaires fonciers, qui comprenaient leur environnement local, connaissaient leurs voisins et ne vivaient pas dans une société hautement industrialisée.
Comme l’a dit Lippmann, « l’idéal démocratique, tel que Jefferson l’a façonné, consistait en un environnement idéal et une classe choisie ». Malgré le racisme et le sexisme, cet environnement ne ressemble en rien au nôtre, et l’éventail des questions sur lesquelles les électeurs sont censés être informés aujourd’hui dépasse largement les exigences de l’époque de la fondation de la démocratie.
La question pour Lippmann n'était donc pas de savoir si l'individu moyen était suffisamment intelligent pour prendre des décisions en matière de politique publique, mais plutôt de savoir si l'individu moyen pourrait un jour en savoir suffisamment pour choisir intelligemment. Et il a fait valoir ce point en se servant de lui-même comme exemple :
Je sympathise avec [le citoyen], car je crois qu’on lui a confié une tâche impossible et qu’on lui demande de pratiquer un idéal inaccessible. Je le pense moi-même car, bien que les affaires publiques constituent mon principal intérêt et que je consacre la majeure partie de mon temps à les observer, je ne trouve pas le temps de faire ce que la théorie de la démocratie attend de moi, c’est-à-dire savoir ce qui se passe et avoir une opinion digne d’être exprimée sur chaque question à laquelle est confrontée une communauté qui se gouverne elle-même.
Vous pourriez lire ceci et penser : « Les citoyens n’ont pas besoin d’avoir une opinion éclairée sur chaque problème auquel la communauté est confrontée. Au lieu de cela, ils choisissent le parti en qui ils ont confiance pour servir leurs intérêts. » Selon cette vision, les citoyens n’ont pas besoin d’être « omnicompétents », pour reprendre l’expression de Lippmann, ils doivent simplement en savoir assez pour choisir l’équipe qui représente leurs intérêts. Mais pour cela, les électeurs doivent savoir quels sont leurs intérêts et quel parti les représente réellement.
Il n’existe pas de vision de la démocratie digne d’être défendue qui ne suppose un niveau minimum de compétence de la part d’une majorité d’électeurs. Lippmann doutait qu’un tel niveau de maîtrise soit possible car les citoyens sont trop éloignés du monde pour pouvoir formuler des jugements concrets. Par conséquent, ils sont contraints de vivre dans des « pseudo-environnements » dans lesquels ils réduisent le monde à des stéréotypes afin de le rendre intelligible.
Lippmann faisait partie intégrante du Comité d'information publique, l'agence chargée de créer de la propagande pour susciter le soutien à la Première Guerre mondiale. Cette expérience lui a appris à quel point le public était manipulable, à quel point les gens se laissaient facilement séduire par des récits convaincants. On nous parle du monde avant de le voir, nous imaginons des choses avant de les vivre, et nous devenons les otages de ces idées reçues.
Ces récits sont une défense contre l’incertitude. Ils nous présentent une image ordonnée du monde, sur laquelle nos goûts, nos stéréotypes et nos valeurs sont ancrés. C’est pourquoi il est si difficile de séparer les gens de leurs dogmes. « Toute perturbation des stéréotypes », dit Lippmann, « ressemble à une attaque contre les fondements de l’univers… C’est une attaque contre les fondements de notre univers. »
Lippmann affirme que les préférences des électeurs ne sont pas basées sur des connaissances directes et certaines, mais sur des images qui nous sont fournies. La question est alors de savoir d’où nous viennent ces images. La réponse la plus évidente est dans les médias. Si les médias peuvent fournir des images précises du monde, les citoyens devraient avoir les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs démocratiques. Lippmann affirme que cela fonctionne en théorie, mais pas en pratique. Le monde, affirme-t-il, est vaste et il évolue rapidement, et la vitesse de communication à l’ère des médias de masse oblige les journalistes à s’exprimer par le biais de slogans et d’interprétations simplifiées. (Et cela ne touche même pas au problème de l’esprit de parti dans un paysage médiatique commercialisé.)
Au début du livre, Lippmann cite un passage célèbre de la République de Platon qui décrit les êtres humains comme des habitants d'une caverne qui passent leur vie à observer les ombres sur un mur et prennent cela pour leur véritable réalité. Notre condition actuelle n'est guère différente, sous-entend Lippmann. Nous sommes enfermés dans une caverne de représentations déformées des médias et nous prenons nos images caricaturales du monde pour un reflet fidèle de ce qui se passe réellement.
Lippmann a anticipé bon nombre de ces problèmes, et pourtant on ne peut pas s'intéresser à sa critique sans se demander ce qui va suivre. Malheureusement, la vision alternative de la démocratie n'est pas vraiment une vision de la démocratie.Le mieux qu’il puisse faire, c’est de faire appel à une « classe spécialisée » d’experts en sciences sociales qui opèrent en dehors des électeurs et des politiciens. En théorie, il y aurait une cohorte d’experts pour chaque domaine de l’administration, et ces experts examineraient les faits avec compétence, puis conseilleraient les responsables gouvernementaux. Lippmann pensait qu’un tel système séparerait la « collecte de connaissances » du « contrôle des politiques ». Et, plus important encore, il garantirait que les experts resteraient financés de manière indépendante et donc exempts de tout motif de corruption.Dewey l’a probablement mieux exprimé : « Aucun gouvernement d’experts dans lequel les masses n’ont pas la possibilité d’informer les experts de leurs besoins ne peut être autre chose qu’une oligarchie gérée dans l’intérêt de quelques-uns. » Si Lippmann avait eu gain de cause, le public serait libéré de ses fictions oppressives, mais au prix de tout ce qui touche à la démocratie.
Pour Dewey, tout se résumait à une simple question : qui a le plus besoin d’être éclairé, les citoyens ou les administrateurs ? Ce que Lippmann voulait, qu’il en soit conscient ou non, c’était transformer en permanence les citoyens en spectateurs. Il partait du principe que l’opinion publique était la masse des individus possédant une représentation correcte du monde et que, comme ils ne pouvaient pas le faire, ils devaient être exclus du processus de décision.
comment pouvons-nous donner un sens à cela ?
La démocratie a survécu à des événements bien pires que Trump et le Brexit.
La célèbre critique de la démocratie de Walter Lippmann revisitée.
par Sean Illing décembre 2018, https://www.vox.com/2018/8/9/17540448/walter-lippmann-democracy-trump-brexit
dénoncer l'hypocrisie et de questionner la vérité
Voici les œuvres "Les Provinciales" de Pascal Blaise et "L'Art du mensonge politique" de Jonathan Swift présentent des similitudes intéressantes, notamment dans leur approche critique des mœurs et des institutions.
1. Critique de l'hypocrisie:
Dans "Les Provinciales", Pascal critique les jésuites et leur manière de défendre des positions morales douteuses sous couvert de rationalité et de spiritualité. Swift, dans "L'Art du mensonge politique", dénonce également l'hypocrisie des politiciens et leur manipulation de la vérité pour servir leurs intérêts.
2. Utilisation de la satire :
Les deux auteurs emploient la satire pour exposer les travers de leur époque. Pascal utilise le dialogue et l'argumentation pour mettre en lumière les incohérences des jésuites, tandis que Swift utilise un ton plus mordant et ironique pour critiquer les abus de pouvoir et la manipulation politique.
3. Réflexion sur la vérité et le mensonge :
Pascal s'interroge sur la vérité dans le contexte de la foi et de la raison, tandis que Swift explore la nature du mensonge dans le domaine politique. Tous deux soulignent les dangers de la manipulation de la vérité, que ce soit dans la religion ou dans la politique.
4. Engagement intellectuel :
Les deux œuvres montrent un engagement fort des auteurs envers les questions éthiques et sociales de leur temps. Pascal défend une vision de la foi éclairée par la raison, tandis que Swift appelle à une prise de conscience critique des pratiques politiques.
En somme, bien que leurs contextes soient différents, "Les Provinciales" et "L'Art du mensonge politique" partagent une volonté de dénoncer l'hypocrisie et de questionner la vérité à travers la satire, en mettant en lumière les abus de pouvoir et les manipulations intellectuelles.
C2ki
Info archive :
Lire
https://archive.org/details/lesprovinciales
https://blaisepascal.bibliotheques-clermontmetropole
https://www.anthologialitt.com/post/jonathanswift-l-artdumensongepolitique
Info plus